Génocide ouïghour : l’émergence d’un consensus scientifique
Jeudi 20 janvier 2022 fut un jour historique pour la France et pour le peuple ouïghour. Ce jour-là, l’Assemblée nationale française vota presque à l’unanimité en faveur d’une résolution pour « [L]a reconnaissance et la condamnation du caractère génocidaire des violences politiques systématiques ainsi que des crimes contre l’humanité actuellement perpétrés par la République populaire de Chine à l’égard des Ouïghours ».
Ce vote favorable a eu lieu après que des parlementaires de l’Assemblée nationale se sont informés de la définition juridique du génocide et de son applicabilité à la situation ouïghoure, et était le résultat du travail qu’ils ont effectué par la suite au sein de leurs groupes parlementaires. Ils se sont familiarisés avec la situation par le biais de témoignages de personnes ouïghoures ayant survécu à l’internement, ainsi qu’en consultant les travaux de spécialistes en études ouïghoures et chinoises et en droit. C’était donc un vote délibéré et éclairé.
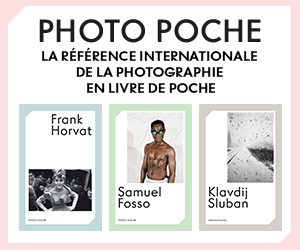
Cependant, il semble que la confusion persiste autour de l’utilisation du terme « génocide » appliqué à la situation ouïghoure. Ce texte ne prétend pas aborder tous les arguments qui ont circulé avant, pendant et après les débats tenus à l’Assemblée nationale. Néanmoins, nous estimons important de réagir à l’argument avancé selon lequel il n’existe pas de « consensus scientifique » sur l’application du concept de génocide aux politiques menées par la République populaire de Chine (RPC) à l’encontre du peuple ouïghour. Nous répondrons également à l’affirmation selon laquelle l’appellation de génocide n’est pas pertinente car la situation ne présente pas de massacres de masse.
Nous aborderons donc d’abord la notion de génocide par le biais de sa définition juridique, en expliquant comment, selon le texte de loi et la jurisprudence qui l’accompagne, il est pertinent de considérer qu’un génocide a lieu au sein de la Région ouïghoure. Nous nous tournerons ensuite vers le domaine universitaire des é
